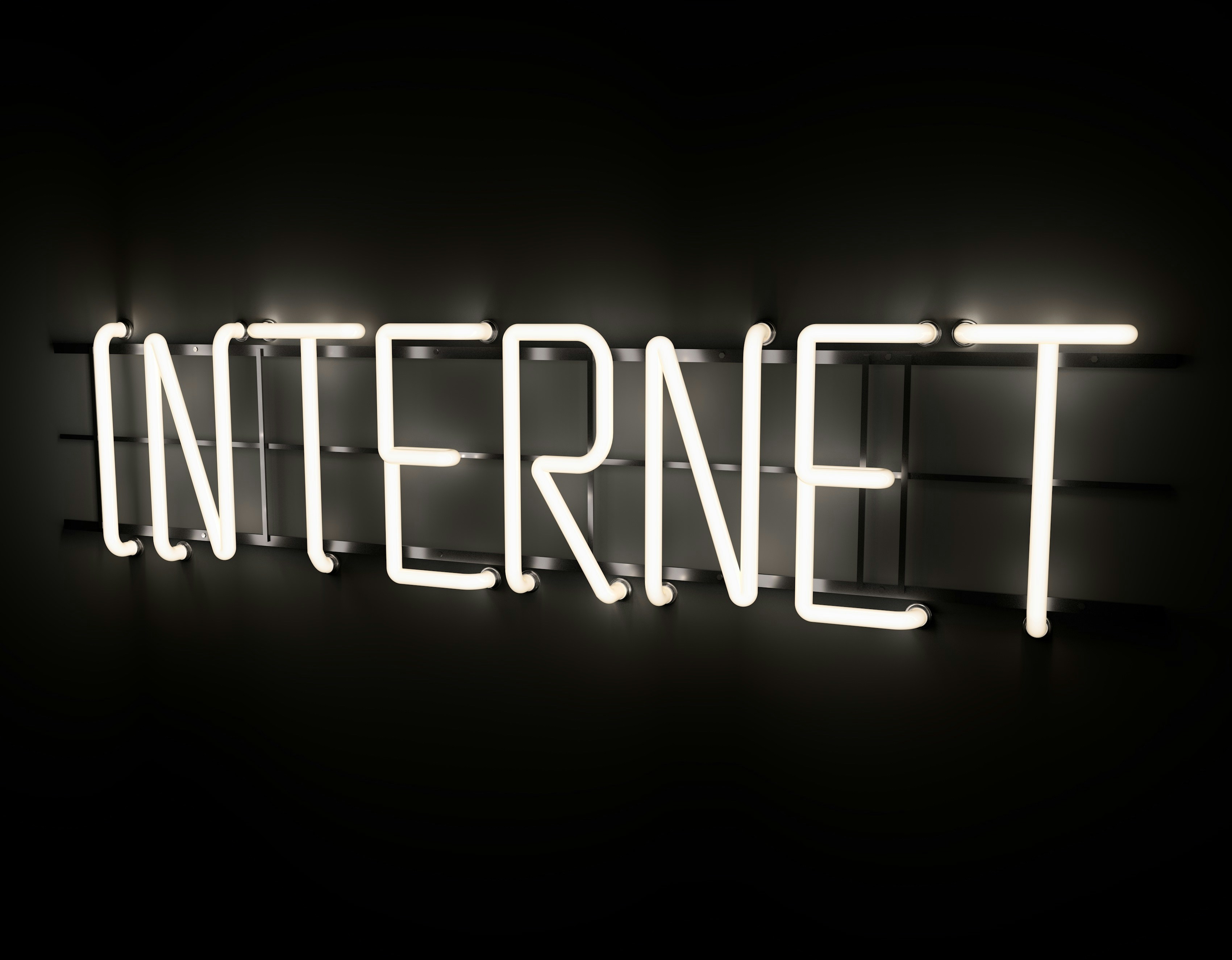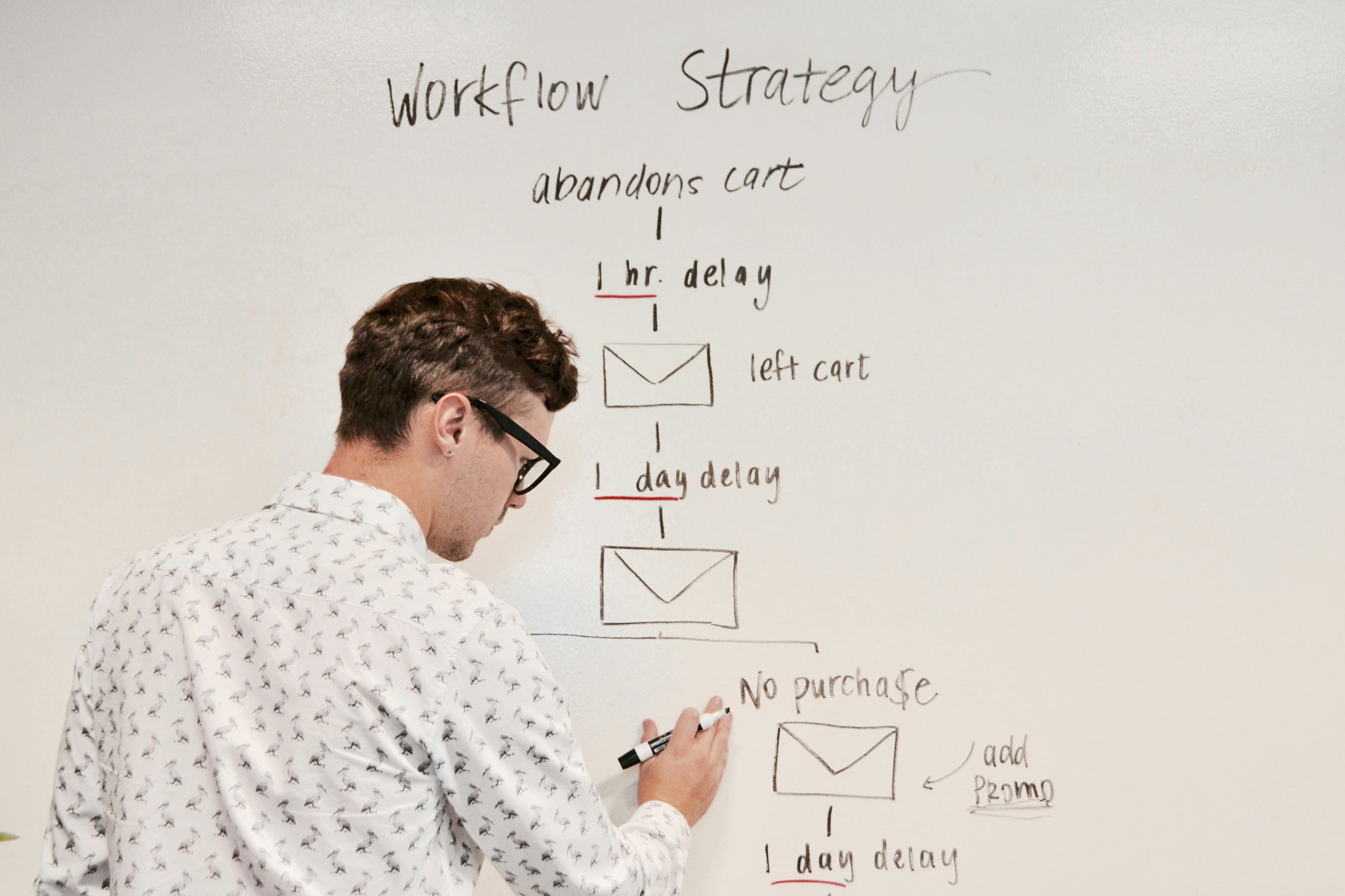Une préoccupation devenue structurante pour les entreprises
Plus personne ne découvre aujourd’hui l’importance de la cybersécurité. Mais entre en être conscient et s’y atteler concrètement, il y a un monde. Pour beaucoup d’entreprises, la gestion des données sensibles reste un angle mort stratégique : pas assez documentée, pas toujours bien priorisée, souvent abordée sous un angle technique plutôt que métier. Pourtant, dans les environnements B2B où les flux d’informations critiques circulent à haute fréquence (RH, finances, R&D, relations fournisseurs…), une faille peut rapidement virer à la catastrophe opérationnelle.
La question n’est plus « Faut-il se protéger ? », mais bien « Comment ? », « À quel niveau ? », et « Jusqu’où aller sans freiner l’agilité business ? ». C’est à cette articulation entre performance et confiance que se joue aujourd’hui la véritable stratégie de protection des données.
Ce qu’on appelle vraiment une donnée « sensible »
Pas besoin d’être dans le secteur bancaire ou médical pour manipuler des données sensibles.
Dans un contexte B2B, ces informations peuvent prendre de nombreuses formes :
- Coordonnées et identifiants des collaborateurs ou clients
- Données de paie, contrats, dossiers RH
- Brevets, secrets industriels, roadmaps produits
- Accords de partenariat, grilles tarifaires, résultats financiers
- Échanges confidentiels entre parties prenantes
La sensibilité d’une donnée n’est donc pas toujours liée à sa nature intrinsèque, mais au préjudice potentiel en cas de fuite, d’altération ou de mauvaise utilisation.
Exemple : un fichier Excel contenant les montants de remises appliquées à chaque client est souvent perçu comme « banal ». Pourtant, exposé à un concurrent ou diffusé en interne sans contrôle, il peut fragiliser la position commerciale de l’entreprise.
L’erreur courante : confondre outil de sécurité et politique de sécurité
Investir dans une solution de cybersécurité ne suffit pas. Beaucoup d’organisations s’équipent d’un pare-feu nouvelle génération, d’un antivirus pro ou d’un système de sauvegarde robuste, puis se pensent couvertes. Or, la protection des données sensibles repose avant tout sur un cadre clair, partagé, aligné sur les usages métiers.
Ce cadre comprend :
- Une cartographie précise des données sensibles
- Des règles d’accès et de partage définies par profils
- Des procédures en cas d’incident (fuite, perte, attaque)
- Une formation régulière des collaborateurs
- Une vigilance sur les outils tiers (notamment dans le cloud ou les intégrations SaaS)
C’est ce qu’on appelle une politique de sécurité des données, dont l’outil n’est qu’un des leviers d’application.
Des failles humaines avant d’être techniques
Un rapport de Verizon (2024) révélait que 74 % des brèches de sécurité impliquent une erreur humaine. Mauvais mot de passe, pièce jointe ouverte un peu trop vite, mauvais destinataire dans un envoi, usage d’un outil grand public non sécurisé… Les exemples sont nombreux.
Cela ne veut pas dire que les collaborateurs sont incompétents. Cela signifie qu’ils sont souvent mal accompagnés, mal formés, voire mal sensibilisés.
Quelques pistes d’action efficaces :
- Instaurer des campagnes de phishing test suivies de debriefs pédagogiques
- Créer des protocoles de bon usage IT en langage simple (pas un document de 40 pages)
- Organiser des ateliers entre les équipes IT et les métiers pour construire ensemble les bonnes pratiques
- Intégrer la sécurité dès l’onboarding d’un salarié, pas en post-scriptum
Intégrer la sécurité dans les process métiers, pas en périphérie
La protection des données ne doit pas devenir un frein à la fluidité. C’est même l’inverse : lorsqu’elle est bien pensée, elle crée de la sérénité dans les échanges, réduit les frictions, et renforce la confiance entre équipes ou partenaires.
Prenons un cas concret :
Une entreprise industrielle équipe ses commerciaux avec une solution de CRM mobile.
Plutôt que de limiter leur usage pour éviter les risques, elle choisit de :
- Définir les données visibles hors ligne
- Activer un chiffrement automatique des échanges
- Déployer une authentification biométrique sur l’appli mobile
- Tracker les accès inhabituels pour enclencher des alertes
Résultat ? Une mobilité commerciale fluide, sans prise de risque excessive.
Ce type d’approche — intégrée, sur mesure, co-construite — est bien plus efficace qu’un empilement de règles descendantes.
Le rôle structurant du RSSI… ou de son équivalent
Dans les grandes entreprises, la fonction de Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) est désormais bien installée. Mais dans les PME et ETI, ce rôle est souvent flou, éclaté, voire inexistant.
Pourtant, même sans RSSI à temps plein, il est crucial de désigner un référent, capable de :
- Porter la stratégie de sécurisation au niveau de la direction
- Travailler avec les équipes métiers pour adapter les règles
- Assurer une veille réglementaire (RGPD, NIS2, etc.)
- Coordonner les réponses en cas d’incident
La sécurité des données ne peut plus être uniquement un sujet IT. Elle doit s’infuser dans le pilotage global de l’entreprise.
Conclusion : ne pas subir la sécurité, mais l’utiliser comme levier de confiance
Protéger ses données sensibles n’est pas une charge. C’est un actif stratégique.
C’est ce qui permet d’ouvrir sereinement de nouveaux marchés, d’intégrer des outils cloud innovants, de collaborer avec des partenaires, de rassurer des clients grands comptes… bref, de faire avancer son entreprise avec un socle solide.
Si vous vous posez la question de votre niveau de maturité en la matière, pourquoi ne pas en discuter ?
Chez Eckert Mathison, nous aidons les équipes marketing, IT et métiers à structurer une stratégie de sécurisation alignée avec leurs enjeux business.
Contactez-nous pour un échange confidentiel ou une session de cadrage gratuite.